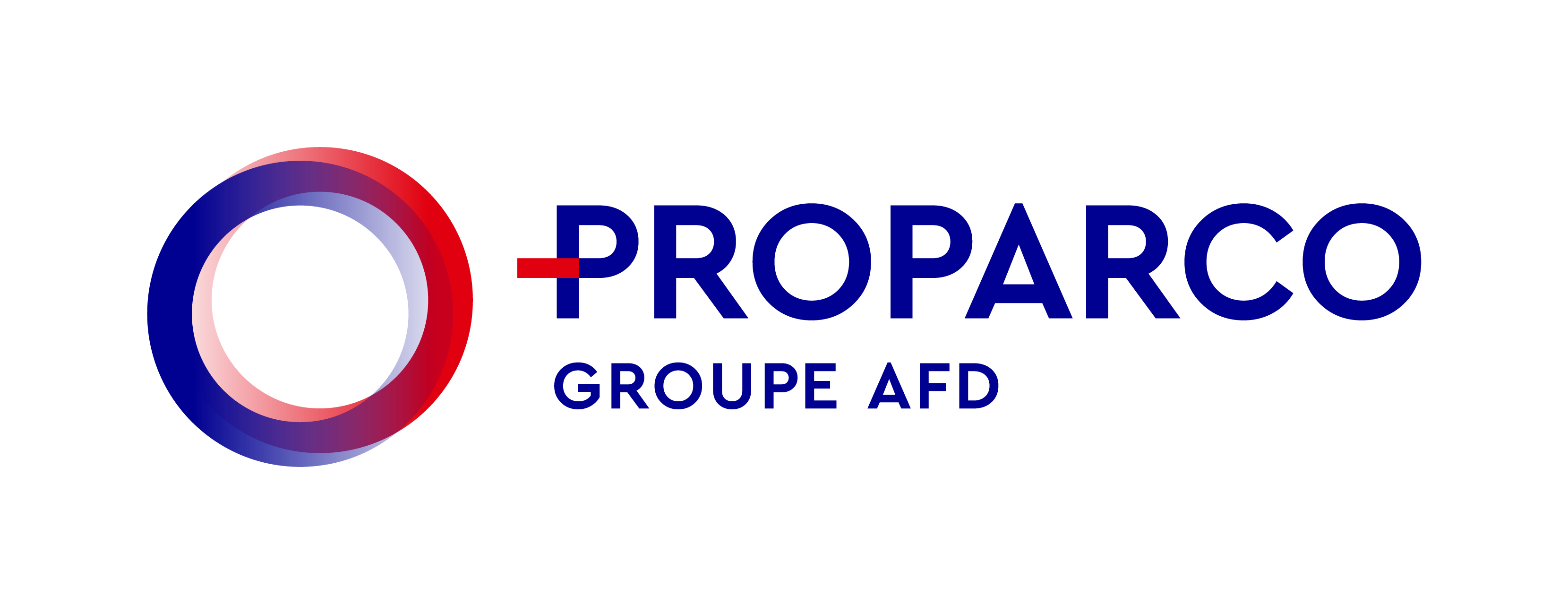Partager la page
La finance durable en action : quand les acteurs financiers transforment leur modèle
Publié le


Secteur Privé & Développement - Business & Climat : de l'ambition à l'action
Proparco publie une édition hors-série de sa revue Secteur Privé & Développement, consacrée au rôle stratégique du secteur privé et des institutions financières face à l’urgence climatique.
Pour renforcer leur action en faveur de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à ses effets néfastes, les institutions financières se réforment. Elles repensent leurs processus, leurs produits et les conditions d’accès à leurs services pour amplifier la décarbonation. Toutes celles qui sont engagées dans cette démarche partagent des points communs : un engagement interne fort, la conviction de trouver dans ce nouveau cadre de véritables opportunités d’affaires, la reconnaissance du rôle essentiel des institutions de financement du développement (IFD) dans le passage à l’échelle. La priorité est souvent donnée aux petites et moyennes entreprises, qui constituent le cœur de l’économie réelle.
Malgré des contextes économiques, sociaux, géographiques et géopolitiques très différents, de nombreuses institutions financières adoptent des approches semblables pour proposer des produits de financement responsables à la fois pratiques et commercialement viables. L’importance de l’engagement interne est un point commun à toutes ces institutions. « First Rand a décidé d’intégrer la prospérité partagée dans son cadre stratégique. Cela a émergé pendant la période du Covid. Pour l’équipe dirigeante, il devenait de plus en plus difficile de dire “nous prospérons” quand notre pays, lui, ne le faisait pas », révèle Bhulesh Singh, trésorier du groupe sudafricain First Rand Bank.
La banque a donc revu ses priorités pour mieux contribuer au bien-être de la société, et « non plus seulement générer du profit ». « Nous sommes dépositaires d’une immense quantité d’épargne des citoyens du pays. Et nous nous sommes demandés : que la société souhaiterait-t-elle que nous fassions de toute cette épargne ? »
Tester et acculturer en interne
Au Costa Rica, la trajectoire de Banco Promerica repose, elle, sur un double mouvement: un engagement fort de la direction générale et la mobilisation des champions verts locaux. Michelle Espinach, Sustainable Bank Manager de Banco Promerica Costa Rica, explique : « Nous avons fait du financement vert avant même que l’expression le mot existe, sans taxonomie, et avec le soutien d’IFD comme Proparco. » Le choix d’adhérer à la Net Zero Banking Alliance a marqué un tournant : « Les banques qui ont signé cet accord ont pris des risques, car décarboner un portefeuille est une tâche complexe. Mais un client plus responsable est aussi plus rentable, donc plus solvable. Tout le monde y gagne ». Michelle Espinach plaide pour un rôle plus offensif des institutions financières : « Nous devons utiliser notre capacité à financer l’économie au service du bien commun. Si toutes les banques décidaient de ne plus financer les plus gros pollueurs, cela changerait notre pays instantanément. »
La conviction des banques est que pour vendre la durabilité, il faut l’incarner. « Car si tout le monde dans l’institution comprend ce qu’est la durabilité, alors on peut la vendre. Sinon, on ne peut pas pénétrer le marché », estime Alex Mantua, directeur général de ProCredit en Géorgie. Ce groupe, dont les actifs sont majoritairement dédiés aux petites et moyennes entreprises du pays, a ainsi choisi depuis 2010 de former chaque année ses 450 employés : « une seule fois ne suffit pas, il faut répéter. »
En parallèle, la banque a d’abord mis en œuvre elle-même les solutions qu’elle voulait commercialiser. « En 2015 ou 2016, quand j’ai demandé à mes collègues de proposer un projet de panneaux solaires pour notre siège, le temps de retour sur investissement (TRI) était de 25 ans. Ce n’était pas possible. Puis le coût a baissé, et en 2019-2020, nous avons de nouveau évalué le temps de retour sur investissement. Une fois descendu à 9 ans, nous nous sommes dit : maintenant, on le fait », raconte-t-il.
Tester en interne a rendu l’offre plus convaincante pour les clients, même s’il a fallu encore réduire le TRI à 7 ans maximum. En intégrant subventions et taux d’intérêt réduits, ProCredit a ainsi calibré son modèle et lancé un écoprêt pour l’installation de panneaux solaires destiné aux PME, avec un processus d’approbation automatique fondé sur les données financières et la surface disponible. Il a aussi encouragé l’électromobilité en remplaçant tout d’abord sa propre flotte, puis en facilitant de la même façon des prêts permettant d’y accéder.
Produits accessibles pour faciliter la décarbonation
Le groupe Kenya Commercial Bank (KCB), membre de la Net Zero Banking Alliance, fait preuve du même état d’esprit proactif. Comme le précise Eric Naivasha, responsable Finance durable pour le groupe, KCB a identifié dans un premier temps trois cibles d’action prioritaires: le transport, l’immobilier commercial et les prêts aux entreprises. « 90% de nos émissions viennent des camions. Nous avons donc développé une stratégie de décarbonation par segment : deux-roues, véhicules légers, poids lourds… »
La trajectoire adoptée par KCB prévoit que 60% des nouveaux financements de véhicules se porteront sur une motorisation électrique d’ici 2040, avec un arrêt total des prêts pour les véhicules thermiques au-delà. Plus globalement, le groupe vise 25 % de portefeuille vert d’ici deux ans, soit 5 à 10 milliards de dollars d’investissements. Mais Eric Naivasha insiste : la réussite dépend moins des plans que des compétences humaines. « Tant que nos chargés de clientèle ne comprendront pas la stratégie, elle restera sur le papier. Il faut former le personnel, mais aussi les clients, jusqu’au petit agriculteur qui ignore que le dérèglement climatique réduit ses récoltes. » Pour lui, la transition doit devenir un levier d’opportunités et concerne tout aussi bien l’irrigation et les serres, que la mise en place globale d’une agriculture résiliente.
Mais pour qu’elle puisse pleinement jouer ce rôle, il faut rendre accessible (localement) l’offre de financements durables. C’est d’ailleurs une autre exigence commune aux institutions. Les actions de Sterling Bank au Nigéria l’illustrent : en 2024, celle-ci a financé l’achat d’une flotte de 120 tricycles électriques pour soutenir l’entrepreneuriat et la mobilité des femmes à Kano, ville de 14 millions d’habitants.
« Le but était de fournir aux femmes un moyen de transport, non seulement qu’elles possèdent mais aussi qu’elles ont cocréé, qui soit économiquement viable et qui améliore l’économie locale », confie Abubakar Suleiman, directeur général de Sterling Bank. Aujourd’hui, la flotte, équipée de batteries interchangeables alimentées par énergie solaire, totalise 450000 kilomètres parcourus. «En trois jours, un conducteur peut gagner l’équivalent d’un salaire mensuel minimum », chiffre-t-il. Et d’ajouter : « Tout cela représente un investissement de 400 000 à 500 000 dollars seulement. Nous avons déjà évité l’émission de 26,1 tonnes de CO2 avec seulement 120 tricycles. Imaginez l’impact avec des dizaines de milliers; à grande échelle, cela ne nécessitera pas de subvention. »
Vers un passage durable à l’échelle
Et les banques le soulignent : la mise à l’échelle exige de repenser autant les objectifs, les organisations que les outils opérationnels. Face aux enjeux mondiaux comme face à leurs contextes locaux, la transition énergétique n’est pas une simple formalité : elle est une condition de pérennité autant qu’un levier de compétitivité.
Mais cela suppose de nouvelles stratégies commerciales, une gestion fine du risque et la transformation structurelle des économies qu’elles financent. Pour Rachael Antwi, Head of Sustainability du groupe Ecobank, le bilan de la banque reflète son engagement dans la finance climat : « Ce n’est pas une question de conformité, mais de survie – pour la banque et pour les économies dans lesquelles nous investissons. » Ecobank a lancé sa propre démarche, qui comprend l’analyse de portefeuilles, un plan de décarbonation avec une politique de sortie du charbon et le ciblage des secteurs à fort potentiel vert. « Notre ambition : mobiliser 5 milliards de dollars en six ou sept ans pour la finance climat. » Cette stratégie s’appuie sur une logique d’apprentissage continu : formation interne, audits de données et création d’un outil numérique ad hoc pour analyser et suivre les risques physiques et de transition. Rachael Antwi pointe d’ailleurs la difficulté (et l’importance) d’obtenir des données fiables en Afrique et la nécessité d’un système de reporting intégré.
Eric Campos, directeur de l’Engagement sociétal de Crédit Agricole S.A., expose la complexité du développement durable dans un groupe dont les encours dépassent 1000milliards d’euros. « Le défi n’est pas de verdir nos encours, mais de verdir l’économie.» Depuis 2019, la stratégie climatique du groupe s’appuie sur un comité scientifique et sur l’engagement direct du président et du directeur général : « Sans soutien des instances dirigeantes, n’essayez même pas de mettre en place une stratégie climat. C’est totalement impossible. » L’enjeu est double : maintenir la performance financière tout en assumant la performance carbone. Entre 2020 et 2024, la banque a augmenté ses encours dans les énergies renouvelables de 140% et réduit ceux des énergies fossiles de 40 % : « Il faut impérativement transformer la contrainte climatique en opportunité d’affaires. »
De la promesse au plan : bâtir une transition crédible
Passer à l’action en matière d’atténuation climatique nécessite une stratégie claire et un plan structuré pour repenser sa trajectoire de développement ainsi que ses arbitrages internes. « Un plan de transition n’est pas une stratégie annexe. Ce n’est pas un module RSE supplémentaire. C’est la façon dont une entreprise planifie la transformation de son modèle économique pour l’aligner sur un objectif fort de neutralité carbone à l’horizon 2050 », souligne Ilaria Balletto, responsable de l’initiative ACT (Assessing Low Carbon Transition) à l’ADEME (Agence de la transition écologique). En France, ce référentiel, porté par l’ADEME, aide les entreprises à évaluer la faisabilité de leur trajectoire climatique, en structurant des objectifs cohérents, des moyens dédiés et des indicateurs vérifiables.
Le groupe Engie s’y est appuyé pour construire un plan aligné avec son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2045. « Nous utilisons notre plan de transition pour définir les indicateurs clés (KPIs) de nos financements. Aujourd’hui, nous avons plus de 10 milliards d’euros de financements adossés à des objectifs clairs d’émissions, avec des cibles annuelles », détaille Adrien Koenig, responsable Structured Finance chez Engie.
En Géorgie, TBC Bank a engagé une démarche progressive. « Même si nous ne savions pas encore comment mesurer les émissions de notre portefeuille, nous pouvions commencer par faire quelque chose de compréhensible pour nos clients. Nous avons donc d’abord fixé un objectif de 30 % de financements durables », explique Maka Bochorishvili, responsable RSE chez TBC Bank. Pour l’atteindre, la banque a accompagné ses clients industriels les plus émetteurs y compris sur la conception de leurs produits grâce à une équipe d’ingénieurs intégrée à l’établissement.
Sur le continent africain, où l’évitement des émissions prime sur la réduction, Helios – société de capital-investissement dédiée à l’Afrique –, a développé une approche contextualisée. « Nous avons constitué une équipe pour mesurer et comparer les émissions selon les standards mondiaux en les adaptant à l’Afrique », précise Tavraj Banga, Partner chez Helios Investment Partners. Une usine nigériane de transformation de tomates, auparavant dépendante des importations chinoises, a ainsi pu relocaliser toute sa chaîne logistique. Ce repositionnement stratégique a permis de réduire l’empreinte carbone, de sécuriser les approvisionnements pendant la pandémie et d’améliorer la rentabilité. Un exemple concret où la transition climatique agit comme levier économique.
Dépasser les approches traditionnelles
Proactifs et volontaristes, les acteurs financiers qui s’engagent et rendent concrète la finance climat soulignent aussi les avantages qu’elles ont à pouvoir s’appuyer sur les institutions de financement du développement (IFD) comme Proparco. Le témoignage de Hawshi Shawa, président du groupe Bank of Palestine est très révélateur : « grâce à l’effet catalyseur des programmes de l’AFD et de Proparco, nous avons pu prêter davantage dans un contexte difficile ».
Les projets Sunref I & II ont permis de financer des fermes solaires de 0,5 à 5 MW et, depuis 2018, plus de 50 millions de dollars de prêts verts ont été accordés aux PME pour améliorer leur efficacité énergétique. «Cela montre l’effet d’échelle rendu possible avec les bons programmes : une composante de réduction du risque, une composante de subvention, et surtout un accompagnement technique pour former nos équipes, sensibiliser les clients, et les inciter à adopter ces solutions », ajoute-t-il.
Au-delà, quelle que soit leur géographie, toutes les banques soutiennent l’innovation (via des fonds de capital-risque, des pôles d’accélération, etc.) en encourageant de plus en plus les start-up engagées dans le développement durable. Objectif: libérer le dynamisme entrepreneurial souvent freiné par les procédures bancaires traditionnelles, pour encore accélérer la lutte contre le dérèglement climatique et impulser concrètement un développement durable.
Au Nigeria, Proparco accompagne First Bank dans le développement d’une stratégie climat
En 2022, Proparco a accordé un prêt et un accompagnement technique de deux ans à First Bank Nigeria pour soutenir l’intégration des principaux enjeux climatiques à sa stratégie et à ses opérations. La banque a ainsi lancé plusieurs chantiers en parallèle :
- estimation de ses émissions de gaz à effet de serre (opérationnelles et financées)
- analyse des risques climatiques physiques et de transition auxquels son portefeuille est exposé
- analyse des principales opportunités de finance climat concernant l’atténuation sur le marché nigérian
- formation du personnel de la banque
- intégration de ces différents enjeux climatiques à ses procédures et stratégies existantes
Grâce à ces efforts, First Bank dispose aujourd’hui d’un niveau de référence concernant ses émissions opérationnelles et financées sur lequel elle peut baser ses objectifs de décarbonation. Elle a aussi pu développer des modules de formation aux enjeux climatiques pour son personnel ainsi qu’un cadre d’analyse des risques climatiques pour ses opérations. Ce travail a également permis à la banque de commencer à réfléchir au développement de produits financiers verts ou encore au rôle qu’elle pourrait jouer dans la transition de ses clients les plus émissifs.
Ce projet pilote, qui a impliqué de nombreuses équipes de la banque, a mis en lumière les étapes nécessaires pour que les enjeux climatiques soient intégrés au sein d’une organisation. Il a aussi montré qu’il est indispensable – et très vite profitable – de le faire.
Analyse
E-mobilité : sur la route de la dette pour passer à l’échelle
Faire passer le secteur de la mobilité électrique à l’échelle exige de mobiliser la dette. C’est le message véhiculé par trois représentants d’investisseurs majeurs dans la décarbonation de véhicules ...
Publié le 20 novembre 2025
À lire aussi
Pour Banco Promerica, la construction écologique est essentielle à un avenir bas carbone
Publié le 18 novembre 2025
En Afrique subsaharienne, le fonds ARAF renforce la résilience climatique des petits exploitants agricoles
Publié le 12 novembre 2025